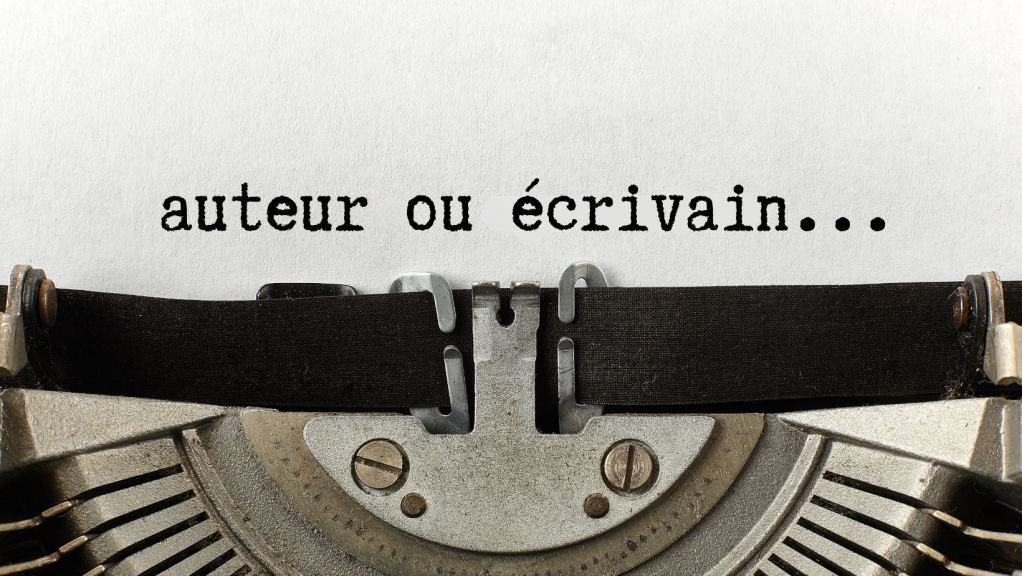Voilà une question qui revient souvent dans la conversation. Surtout chez les autoédités. Avec un petit arrière-goût de jugement. On se dit plus facilement « auteur » comme pour rester humble devant la grande littérature, gardant ainsi à « l’écrivain » ses lettres noblesse.
Eh bien mon propos, aujourd’hui, n’est ni de juger à mon tour ni de classifier, encore moins de jouer au Petit Larousse, mais de partager avec vous une réflexion pour rendre aux auteurs ce qui est aux auteurs et aux écrivains ce qui est aux écrivains. Alors, on y va ?
Figurez-vous qu’il ma fallu pas mal de temps pour arriver à ces quelques réflexions… certain-e-s vont penser : « Yiiiha ! Catarina a découvert l’eau tiède ». Tant pis, je me lance malgré tout.
les auteurs seraient-ils plus humbles que les écrivains ?
Parce que j’en ai entendu de toutes les couleurs à propos du grand écart qui existerait entre « auteur » et « écrivain ». La plupart du temps, cela se résume à « “écrivain”, c’est les bons, les super, les édités, les balèzes ; “auteur”, c’est plus cool, plus proche, presque copain. Les uns sont dans le moule de la littérature, les autres s’en émancipent. Jusqu’à : “les uns sont édités, les autres autoédités”. Les “auteurs” seraient plus légers ; les écrivains, de sérieux professionnels.
Bref, je n’ai jamais entendu traiter du sujet sans sous-entendus.
Et le propos de mon billet est justement celui-ci : apporter une réponse qui reposerait sur des faits concrets, et, subséquemment, contribuerait à une répartition objective et sans a priori des gens de lettres.
Donc, nous sommes bien d’accord qu’il ne s’agit pas d’une différenciation qualitative (dans cet article, je ne me référerais d’ailleurs qu’à des signatures excellentes), mais d’une répartition des rôles. J’y tiens.
Un auteur est un narrateur
Pour moi, un auteur est avant toute chose un narrateur. L’épine dorsale de son œuvre est une histoire magistrale, et magistralement racontée. Ken Follet me vient spontanément à l’esprit. Mais d’autres romanciers et romancières populaires réussissent à captiver leur lectorat avec leurs histoires (Bernard Werber, Delphine Le Vigan, etc.). Et cela est un don, une force. Je n’aime pas que l’on catalogue leur travail de “divertissement”. Pascal nous a bien montré ce qu’est le divertissement de l’esprit : tout est divertissement dès lors que l’esprit s’évade, et, à moins d’être le king ou la queen de la méditation, nos esprits ne sont-ils pas perpétuellement en balade ? Les histoires des conteurs ne font pas que nous distraire, elles nous inspirent, elles nous permettent d’imaginer d’autres mondes, d’autres possibles, certaines ont même le don de nous faire sentir mieux. C’est dire…
Alors, ma foi, direz-vous, si tout cela relève de l’auteur, chère Catarina, que reste-t-il à l’écrivain ?
l’écrivain est un démiurge
L’écrivain me récrée. L’écrivain m’ouvre des portes sur un autre moi-même, sur un autre vous, d’autres univers.
Les portes de la perception pour commencer. L’écrivain utilise l’écriture comme une argile avec laquelle il modèle ses mondes, un marbre dans lequel il sculpte son oeuvre. Il n’intervient pas qu’au niveau de l’histoire, ou disons plutôt que s’il a besoin d’une histoire, c’est uniquement pour l’utiliser comme support, comme prétexte, comme aimant ; mais jamais l’histoire ne prendra le pas sur le travail alchimique du verbe. Certains écrivains ne se gênent pas pour pulvériser la notion classique de narration : Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Michel Butor ou encore Claude Simon. L’écrivain trouve sa trame dans la syntaxe, la sonorité des mots, la ponctuation (toutes les ressources de l’écriture) pour forer dans notre esprit et dans notre chair l’ouverture d’un troisième œil, d’une tierce compréhension.
L’écrivain peut être poète. Par sa pratique et son art de la langue, il déclenche automatiquement l’ouverture de portes insoupçonnées. Il s’immisce en nous par la brèche que créent ses mots ; réveille le dormeur. Il nous électrise. Il peut aller jusqu’à nous inciter à redéfinir notre présence au monde Antonin Artaud, Faulkner, Woolf, Ramuz, Lessing, Dostoïevski, Zweig, sont les noms qui me viennent à l’esprit sans les chercher, Kerouac, Céline… Chez tous ces écrivains, peu importe l’histoire, le voyage est dans l’écriture elle-même. Ce qui, d’ailleurs, les rend intraduisibles (impossible à ma connaissance de rendre en français Kerouac ou Faulkner). S’il y a narration, tant mieux, autrement, on s’en passe, ce qui compte est l’extase et le sens supérieur que leur œuvre fait résonner en nous. L’écrivain est frère du peintre, du musicien. Son écriture est formes et forces, couleurs, relief, perspective, son, harmonie. À l’inverse du narrateur, il ne recherche pas la cohérence du scénario, mais le choc des mots qui viennent frapper contre l’esprit des lecteurs.
À vous, donc, lecteurs, de savoir l’expérience que vous souhaitez vivre. Certains d’entre vous s’ennuient en compagnie des écrivains, parce que ce que vous désirez c’est un “raconteur”, un passeur d’histoires, un aède, un griot, que vous êtes prêts à suivre dans les plus folles équipées. Mais ces mêmes auteurs font bâiller le lecteur qui veut la chair et le sang de la langue, et les scénarios les plus exitants lui tombent des mains avant la dixième pages. Comme si narration et écriture se renvoyaient dos à dos. Mais, objecterez-vous, il existe bien des « narrateurs-écrivains », non ?
Si vous avez des noms… je prends !
Ainsi va le monde. Ainsi va la littérature.